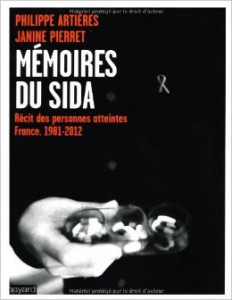Résumé
Note de lecture de l’ouvrage de Philippe Artières et Janine Pierret, Mémoires du sida. Récits des personnes atteintes. France, 1981-2012 publié à Paris chez Bayard en 2012.
Auteur
Charlotte Pezeril (Observatoire du sida et des sexualités)
Pour citer ce texte
Charlotte Pezeril, Compte rendu de l’ouvrage de Philippe Artières et Janine Pierret Mémoires du sida. Récits des personnes atteintes. France, 1981-2012, mars 2013.
Mémoires du sida. Récits des personnes atteintes. France, 1981-2012, Philippe Artières et Janine Pierret, Paris : Bayard, 2012
Cet ouvrage est à la fois passionnant et relativement frustrant[1] , même si cette frustration est largement dépassée par l’intérêt qu’il suscite. Passionnant d’abord parce qu’il revient non seulement sur 30 ans d’histoire de la lutte contre le sida mais finalement aussi, en arrière-fond, sur notre histoire récente, sur les luttes sociales pour la reconnaissance des couples homosexuels, pour la décriminalisation de la toxicomanie, la prise en compte de la parole des malades ou encore la responsabilisation des acteurs politiques. Au-delà même de ces luttes, il décrit le profond changement que le sida a induit dans nos vies et notre rapport au monde : quand il apparaît comme problème public, c’est la rupture avec l’arrogance et les certitudes occidentales, le désarroi face à l’impuissance médicale, le retour de la possibilité de la mort brutale de personnes souvent très jeunes, la remise en cause d’une évolution linéaire et inéluctable vers le Progrès.
L’ouvrage est en même temps frustrant parce qu’on aimerait en savoir davantage. En effet, il est construit à partir d’extraits d’entretiens, assez courts, qui se juxtaposent. L’effort de synthèse et d’analyse doit toutefois être souligné : les auteurs ont réécouté près de 200 entretiens[2] qui s’étalent sur 15 ans (de 1985 à 2000). Ils ont voulu laisser la parole aux personnes atteintes et n’ont donc esquissé que de brèves introductions, très belles, pour chaque période découpée (voir les périodes ci-après). Avant d’aborder plus précisément ces dernières, signalons également que l’ouvrage est profondément émouvant car donner la parole, c’est laisser s’exprimer les doutes, les souffrances, les espoirs de chacun, c’est laisser dire le sentiment d’exclusion et la solidarité, la solitude et les combats collectifs, l’extrême différence des parcours individuels et ce qui les rapproche. La difficulté d’assembler et de découper tous ces témoignages épars explique probablement ce sentiment de frustration pour le lecteur. Selon moi, un ou deux récits beaucoup plus longs auraient permis de suivre des déroulés individuels, avec leurs hésitations, leurs évolutions[3] et leurs paradoxes singuliers, bien qu’ils s’inscrivent dans une histoire commune.
Car cet exercice a le mérite de construire, comme les auteurs l’annoncent en introduction, une « forme de récit collectif » qui finalement met en avant une expérience commune en faisant ressentir pour le lecteur, de façon inédite, les différences et les évolutions de ces expériences sans jamais en faire un objet unitaire et uniforme, en réussissant à saisir la pluralité des vécus. Seul bémol à cette pluralité, que les auteurs reconnaissent : les femmes et les usagers de stupéfiants sont absents des deux premières périodes, de même que les migrants pour toutes les périodes[4].
Deux éléments nous semblent façonner cette expérience collective telle qu’elle est progressivement révélée. En premier lieu, la vie avec le VIH/sida n’est pas seulement une expérience de la maladie, elle est aussi une expérience politique. Si les auteurs ne l’expriment pas comme telle, il me semble que c’est l’une des idées fortes de ce livre, bien que des entretiens plus récents nuanceraient probablement cet engagement. En second lieu, malgré des évolutions thérapeutiques décisives (et donc, pour beaucoup, la transformation en maladie chronique), la constance de la stigmatisation et des discriminations est troublante. Bien qu’elles prennent des formes moins violentes et exclusives (rejet de la famille et refus de soins), elles restent vivaces et décisives dans les trajectoires de vie telles qu’elles se donnent à voir ici. Si des réactions stigmatisantes peuvent durablement marquer certains individus et entraîner un repli sur soi, elles en amènent d’autres à se mobiliser. Le livre rend donc aussi compte de la formidable énergie qui se dégage des mobilisations, des rencontres et des gestes de solidarité racontés par les protagonistes.
Pour préciser davantage ce récit collectif, revenons sur le découpage proposé par les auteurs.
1. La vie avant 1980
L’inclusion de cette période est étonnante. Tout d’abord, parce qu’elle est antérieure à la maladie. Ensuite, parce qu’à lire ces témoignages, on a l’impression de revivre un monde depuis longtemps disparu, quoiqu’il appartienne à un passé tout récent. Cette période est donc doublement intéressante : elle rend compte de la construction individuelle des personnes avant l’arrivée du sida et surtout du regard porté à l’époque sur l’homosexualité, les drogues et l’hémophilie. Dès le départ, les récits fonctionnent de façon parallèle, voire diamétralement opposée. D’un côté, un jeune homme découvre secrètement son homosexualité, en partant aux Etats-Unis ou en arrivant à Paris, il tente de maintenir un mode de vie « respectable », une « façade » dit l’un, avec sa femme, sa famille et aussi avec lui-même (on entend les maladresses, la découverte de ce « nouveau ghetto », enchanteur et honteux, le sentiment d’être « anormal » ou « malade »). Puis il y a les premières mobilisations collectives, manifestations, réunions du FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire), « sorties du placard » qui ne riment toutefois pas toujours avec épanouissement et « libération sexuelle ». D’un autre côté, un homme hémophile raconte ses transfusions bras à bras avec son père car il n’avait pas de sécurité sociale, un autre son enfance dans une institution de laquelle ils n’avaient pas le droit de sortir (à tel point qu’il a eu l’impression de « sortir de prison jeté dans la vie active à 16 ans »), la proximité avec la mort dès la plus tendre enfance, la solidarité forte avec la fratrie qui vit la même situation, cette même éducation « dans un monde de coton ».
Les réalités des vécus sont donc radicalement différentes, même si elles peuvent se retrouver dans une vie à la marge, confirmée explicitement par le seul extrait d’un ancien héroïnomane qui consomme pour se tenir hors de « ce monde qui ne le branche pas ».
2. Les années noires (1981-1986)
L’arrivée du sida est un « événement total » qui bouleverse complètement les politiques, les institutions, les croyances, les pratiques. Comme le soulignent les auteurs, avant 1986 et le test de dépistage, c’est l’hécatombe, les morts qui se multiplient dans l’ignorance, une guerre sans arme, c’est l’impuissance des médecins, la peur des proches, l’angoisse et le désir de vivre et de lutter. « Nous vous écoutons. Nous nous souvenons » disent les auteurs et l’on ressent à travers eux que ces entretiens sociologiques ont été des moments d’échanges intenses et, pour eux aussi, parfois, des moments difficiles. Il semblerait, en quelque sorte, que ce livre soit un hommage que les auteurs voulaient rendre à la mémoire de tous ces anonymes qui se sont livrés à eux et à d’autres sociologues (notamment Michael Pollak, qui décède du sida en 1992).
Face au prétendu « cancer gay », des homosexuels pensent au départ au canular ; avant de paniquer devant ces amis qui décèdent les uns après les autres, ces taches qui se multiplient sur la peau ou ces ganglions persistants. Les hémophiles connaissent le même mouvement de panique, même s’il est moins médiatisé. Certains d’entre eux sont très jeunes et l’apprennent collectivement, en colonie de vacances : « d’un seul coup, on a vu ces infirmières, ces médecins, ces monos, qui avant nous touchaient tout le temps, du jour au lendemain, mettre de l’eau de Javel dans la vaisselle, et nettoyer (…). Ça a vraiment été très traumatisant et on l’a tous vécu comme ça. Le pire, c’est qu’il y avait des mômes qui avaient quatre ans, et on se tapait des crises de pleurs. » La peur, l’incompréhension, le déni sont racontés, tout autant que le point de vue de ceux qui pressentaient ne pouvoir y (r)échapper, tant l’entourage était déjà touché. Les récits témoignent des réactions terribles des médecins et autres soignants, entre l’inscription « sida » au pied du lit d’hôpital, les visites avec masques et gants, la fuite devant l’annonce du diagnostic, les conseils de se tenir éloignés des enfants et de ne plus toucher personne.
Si le choc est rude, certains vont en faire un tournant dans leur vie, tenter d’y puiser des forces et de changer radicalement de mode de vie. L’un attend d’être chez des amis pour ouvrir la lettre de l’hôpital et découvrir avec eux sa séropositivité. Pour un autre, c’est le moment de « décrocher », d’arrêter la came, de construire une nouvelle vie. Il n’empêche que ces années restent des « années noires » dans les souvenirs.
3. La bataille (1987-1995)
Cette période est celle où le sida devient un problème public majeur, au cœur de la vie médiatique et politique. Les campagnes de prévention apparaissent, de même que les associations de malades. Les premiers procès des hémophiles et transfusés font la une des journaux à partir de 1990. Pourtant, les progrès médicaux sont maigres (malgré l’apparition des premiers traitements, l’Imuthiol puis l’AZT) et vivre avec le VIH reste difficile à dire et souvent synonyme de solitude. Cet écart entre discours officiel et vie quotidienne est pesant pour beaucoup. « Une période s’ouvre d’intenses productions discursives et visuelles qui cohabitent avec une difficulté toujours importante à dire sa séropositivité. C’est là le paradoxe de cette période de batailles fortement marquée par la mort et des moments d’intenses mobilisations ».
Les discours deviennent techniques, les personnes parlent de T4, de protocoles, d’essais thérapeutiques, détaillent les mécanismes de réplication du virus : à travers ces précisions, c’est la figure de l’expert profane qui surgit, du patient qui a acquis une solide connaissance de son virus et peut discuter voire affronter son médecin.
L’ouvrage décrit aussi les premiers Etats généraux qui ont lieu à Paris en 1990, la volonté de se retrouver pour s’entraider, s’exprimer et se battre ensemble. Ces moments permettent également à ceux qui ne font pas partie des « groupes à risque » de se visibiliser : les femmes, les hétéros sans passé de toxicomanes, etc. Pourtant, prendre la parole, publiquement ou même dans sa famille, est un pas difficile à franchir. Une femme de 33 ans déclare : « j’ai l’impression que j’ai plus peur de la réaction des autres que de la maladie elle-même ».
4. L’événement de Washington et le traitement dans la vie
En janvier 1996, on annonce au congrès de Washington l’efficacité de l’association de deux antirétroviraux et d’une nouvelle molécule, l’antiprotéase. L’avènement puis la diffusion des trithérapies impulsent graduellement un « changement formidable » dans la vie de la grande majorité des séropositifs. Après les années d’échecs et de peur, l’espoir renaît, la vie se normalise une fois que les premiers effets secondaires des traitements (parfois très lourds) se dissipent et que se routinise la prise de médicaments. Dans le même temps, le sida s’efface de l’espace public, la personne atteinte « retourne à un double silence », celui de sa vie quotidienne et celui de la société qui continue à la stigmatiser malgré les déclarations publiques de solidarité. Pour les auteurs, on a sans doute atteint la fin d’un cycle, qui renferme d’ailleurs selon eux la possibilité de ce récit.
Mais la chronicisation de la maladie pose de nouveaux problèmes, et notamment cette gestion quotidienne et contraignante des médicaments : « Maintenant, puisque je suis tenu par les médicaments, je ne peux pas me permettre d’aller me promener à droite, à gauche et de sauter le traitement. Je crois, à la limite, que c’est plus dur que la maladie elle-même. Tant qu’on est sous traitement, on n’est pas malade, à part la prise de cachet, on ne s’en aperçoit pas, c’est latent. » En outre, s’ajoute pour certains l’enjeu d’une prise discrète de ces médicaments (qui sont passés d’une quinzaine à prendre toutes les quatre heures à moins de cinq en deux prises), dans la famille ou sur le lieu de travail. Car même si les personnes séropositives aimeraient que ce soit « une maladie comme une autre », la révéler à son entourage semble toujours problématique. Comme le disent les auteurs en conclusion, « Le sida est d’abord une maladie de la relation » et elle le reste en 2013.
Après avoir rédigé ce compte-rendu, j’ai découvert l’article d’Eric Favereau paru dans Libération (29/10/2012) estimant que « le résultat (du livre) est à la fois passionnant et frustrant » ! J’ai toutefois décidé de conserver ces adjectifs dans la mesure où ils correspondent le mieux à mon avis et que les arguments développés ne sont pas les mêmes.
Effectués par M. Pollack dès 1985, puis à partir de 1990 par J. Pierret elle-même en collaboration avec D. Carricaburu et M. Duroussy.
Sachant que pour certains, trois entretiens ont été effectués (parfois sur une période de 2 ans).
Ces restrictions ne sont pas un choix des auteurs, mais fonction de leur corpus d’entretiens. Ils l’expliquent d’ailleurs en introduction, d’une part parce que l’épidémiologie touchait peu les femmes dans un premier temps et que les usagers de drogue étaient éloignés des centres de prise en charge, d’autre part en précisant que les migrants restent les grands absents de ce récit, leur parole ayant été rarement recueillie, alors qu’ils sont aujourd’hui massivement affectés (voir p. 22-23).